Prologue
La médecine que j’exerce au quotidien en ce début du xxie siècle ne correspond plus, et de loin, à celle que pratiquaient mes maîtres dans les années cinquante. Le progrès scientifique l’a rendue fiable. L’incertitude et les probabilités invoquées par le célèbre médecin canadien Sir William Osler (1849-1919) reculent au profit de l’affirmation technique et de la preuve statistique. À l’inverse, l’organisation générale de la distribution des soins n’a, elle, guère évolué depuis le Moyen-Âge. Elle s’avère toujours aussi traditionnelle, voire archaïque, reposant sur le bon vouloir, le professionnalisme et l’expérience d’individualités. La salle des malades de l’hospice de Beaune ouverte au xve siècle ressemble en tous points à la chambre d’un hôpital contemporain. Lits, tables de chevet, brocs, cuvettes et linge propre en forment toujours les éléments de base. Mais les instruments de chirurgie ont considérablement évolué : nous sommes passés des pinces rustiques aux ciseaux télé-manipulés. L’informatique et la vidéo-vision ont envahi les blocs opératoires. Cette distorsion entre le progrès rapide de l’art médical, peu à peu transformé en technique, et le maintien d’une distribution désuète des soins explique, pour une grande part, l’ardoise financière qui affole payeurs et politiques. Elle est aussi l’une des causes majeures du malaise que ressentent les professionnels de santé dans notre pays, pourtant classé premier pour son organisation sanitaire par l’OMS.
Parce que l’offre de soins s’est socialisée au point de devenir impersonnelle, les usagers du système ont perdu le sens de leurs responsabilités. Des patients aux médecins, en passant par les administrations et les organismes de l’assurance-maladie, chacun a joué son rôle égoïstement. Nous avons tous espéré tenir bon aussi longtemps que possible dans un système encore solvable, au prix d’une augmentation continue des prélèvements sociaux.
On nous rabâche des slogans éculés, tels que le sacro-saint « droit à la santé ». N’oublions pas « La médecine libérale ou la mort », « Touche pas à ma sécu » ou encore « Venez aux urgences, l’hôpital vous attend » qui dénaturent toute analyse sensée de la situation. Chaque catégorie professionnelle tend sa sébile, espérant un petit geste du bailleur de fonds, persuadée d’être la victime expiatoire du système.
« Droit à la santé » ? Mais pourquoi ne pose-t-on pas, d’abord, la question de nos responsabilités individuelles et collectives ? Des responsabilités qui, elles, sont préalables à tout droit ? Il est plus facile de promouvoir à tout va des droits que de rappeler les vertus citoyennes qui les font naître. J’ai peut-être le droit de « jouir sans entrave » comme le proclamait un tag de mai 1968 ; mais, en contre partie de ce bien-être nirvanique, n’avons-nous pas quelques devoirs préalables ? Là, personne ne répond. On se tait par crainte d’aborder la véritable question : celle des impérities successives ayant entraîné la dégradation de notre système de soins. Conçu dans le contexte socio-économique d’après 1945, au sortir de la guerre, ce système ne correspond plus à la situation et aux évolutions indispensables pour la France du XXIème siècle.
Que le lecteur me comprenne. Ces pages n’ont d’autre but que de susciter un débat, en m’appuyant sur des situations vécues. Ce procédé, il est vrai, est peu habituel au pays de Descartes où l’esprit de raison nous invite à procéder du général au particulier sans tenir compte de l’expérimentation. Quand j’opère, j’établis un plan d’attaque ; mais je suis parfois confronté à une réalité différente de celle que j’avais prévue. Du coup, je procède autrement. À sa manière, ce livre n’a pas d’autres ambitions : être pragmatique. Comme un chirurgien.
Quel gâchis !
Nous vivons sur un système de protection sociale bâti, à l’origine, pour les seuls travailleurs salariés. Mais la société a considérablement évolué tant par la diversification des emplois, la répartition des catégories socioprofessionnelles, les progrès de l’informatisation et la mondialisation de l’économie et les progrès thérapeutiques avec leurs conséquences sur le chômage comme sur l’allongement de la durée de vie.
Dans l’ensemble, les Français ne perçoivent pas l’impact croissant de la globalisation du marché de la santé. Outre la puissance américaine dans ce domaine, avons-nous conscience de la montée en puissance de certains établissements de soins étrangers tout comme l’accélération des délocalisations possibles et rapides de médecins et d’auxiliaires ? À Kuala Lumpur comme à New Delhi, ou Tunis, de remarquables chirurgiens vous opèrent dans des hôpitaux superbes. Les Français rayent ce « tourisme médical » qui, un jour, nous réservera des surprises. Qui empêchera un établissement de soins public ou privé de délocaliser demain la prise de rendez-vous à Marrakech ou à Alger ? Qu’est-ce qui empêchera que des images scanner ne soient lues par des médecins étrangers à diplômes français ou européens exerçant dans leur pays d’origine ?
Fiers de la soi-disant égalité d’accès aux soins grâce à notre Sécurité sociale, nous ne voyons pas que la médecine est en France à dix vitesses. Nous sommes aveuglés par le dogme républicain intouchable. Or, selon la porte du cabinet médical, du dispensaire, de la clinique ou de l’hôpital à laquelle vous frappez, vous serez plus ou moins bien pris en charge. Votre niveau d’information, vos relations, vos moyens financiers déterminent totalement le chemin que vous aurez à parcourir comme malade. Mais il ne faut pas l’ébruiter, au risque, sinon, de remettre en cause notre foi indéfectible en la sainte salvatrice et protectrice, « mater securitas ».
En vingt-cinq ans, une vingtaine de plans de redressement ont été mis en place. Globalement, ils ont tous été incapables de produire autre chose que du déficit. Car ils sont sans réelle envergure. Aucun d’eux n’a, en effet, remis en cause les moyens de production sanitaires, ni leur répartition sur le territoire. Nous avons vécu dans le « touche pas à mon hôpital ou à ma clinique », qui privilégie l’aménagement du territoire plutôt que la qualité des soins. Curieux choix, dicté par des impératifs plus politiques que sanitaires et qui préserve coûte que coûte l’emploi local au prix de risques médicaux accrus du fait de la sous-activité de certains établissements. Par ailleurs la corporation médicale libérale négocie avec l’Assurance Maladie des conventions dites « poly catégorielles » qui ne satisfont personne.
Peut-on comparer un généraliste à un chirurgien ? Tout les sépare, hormis la fatigue du métier. Les risques, la technicité, le coût de la pratique (et en premier lieu celui des assurances en responsabilité civile), le mode d’exercice dit libéral, sous contrat avec un propriétaire d’établissement pour le chirurgien et autonome pour le généraliste : sans vouloir établir une hiérarchie, chacun comprendra bien que nous ne faisons pas la même chose, médecins généralistes, spécialistes, psychiatres ou chirurgiens tout en étant aussi utiles aux malades. Alors pourquoi négocier avec la tutelle en montant sur le même cheval du manège ?
Pour m’en tenir à mon domaine, voilà ce qu’il en est : la chirurgie publique disparaît lentement tant sa faible productivité opératoire n’incite pas les chirurgiens les plus actifs à se donner à fond. Blocs opératoires fermés à 16 heures, temps de nettoyage interminable entre chaque malade, limitation du nombre d’actes pour ne pas générer de déficit, tout plaide pour inciter à fuir le secteur public. Ceux qui restent se divisent en deux catégories : les saints, et il y en a, qui considèrent que leur place est à l’hôpital. Ce sont des apôtres, que je salue. Et les autres qui trouvent dans les établissements publics une niche douillette, où l’on peut sans grand risque faire peu d’opérations. La France qui s’enorgueillit d’un État fort a laissé se développer le secteur libéral chirurgical comme aucun autre pays ne l’a fait au monde. Les dirigeants s’en aperçoivent tout juste pour maintenant crier au rapt. L’accès aux soins ne serait plus égalitaire ! La belle affaire : il ne l’a jamais été. Le secteur libéral assure aujourd’hui près de 70 % de la production opératoire dans tous les domaines de la chirurgie et sans rechigner devant la lourdeur des actes comme certains esprits envieux le colportent. Toutes les données du programme médicalisé des systèmes d’information (PMSI) sont là pour le prouver. En 2005, sur 22 000 ablations radicales pour cancer de la prostate, près de 17 000 ont été réalisées dans les cliniques. Les chirurgiens s’y regroupent pour exercer et des cliniques de 300 ou 400 lits forment de beaux établissements de soins, à l’efficacité redoutable malgré leurs contraintes économiques
La séparation entre organismes et personnels médicaux et sociaux est une autre ineptie, alors qu’ils devraient œuvrer ensemble : l’exclu alcoolique qui vient aux urgences régulièrement pour des complications de sa cirrhose du foie, clochard sympathique que tout le monde connaît bien dans le service, sera admis quelques jours avant de retourner dans la rue. Parce qu’il n’y a aucun relais social, il reviendra quelque temps plus tard frapper à la porte du même l’hôpital, plutôt la nuit, pour y faire un nouveau séjour. Et rebelote !
Pendant le même temps, les généralistes sont de plus en plus désabusés. Ils ne trouvent ni remplaçant, ni successeur. Épuisés par le travail, ils sont dégoûtés par la dégradation de leur métier. Enfermés dans une médecine folle où le spécialiste du pied droit ne sera pas le même que celui du gauche, nous ne voyons pas les dangers de la parcellisation non régulée de notre action. On multiplie les sous spécialités, sans réfléchir si c’est à des médecins, des ingénieurs médicaux ou à leurs assistants qu’il faut s’adresser. On s’installe quand on veut, où l’on veut… Bref, chacun joue perso dans un mode de financement collectif !
Et demain ?
Les Français consacrent aujourd’hui 11 % du PIB aux dépenses de santé, en tirant « à guichet ouvert » sur les fonds de la Sécurité Sociale. Naïvement bercés par la chanson d’une pseudo-sécurité, et d’un égal accès aux soins, ils ne se rendent pas compte qu’ils mettent en péril un système qui, même imparfait, reste l’un des moins mauvais au monde. Pourquoi changer d’habitudes ? La Carte Vitale est créditée… Débitons, débitons.
Nous sommes tous responsables et collectivement coupables. Nul n’échappe à la critique. En campant sur des positions intenables, nous alourdissons la note. Ce n’est pas l’autre qui est responsable, c’est moi, et tous les autres avec. L’enfer c’est donc bien nous ! On s’est mis à « sonner le docteur » sous n’importe quel prétexte. Quelle personne bien éduquée oserait ainsi frapper à la porte de quiconque à toute heure du jour et de la nuit pour voir si ça va ?
Faut-il baisser les bras et changer de métier ? Doit-on se planter devant les portes des facultés de médecine en criant aux étudiants qui vont s’inscrire en première année : « Arrière toute ! Vous vous précipitez vers une impasse : choisissez autre chose » ? Non, bien au contraire. Car à notre époque incertaine et troublée, se dessinent les prémices d’une révolution de l’organisation des soins sans précédent : une délégation des actes médicaux, le partage de l’information médicale entre soignants et soignés, la révision des missions des établissements de soins et d’autres modes de rémunération des médecins. Notre pays, s’il le voulait, pourrait montrer le chemin d’une organisation sanitaire efficace et solidaire. Au centre géographique de l’Europe, la France pourrait attirer beaucoup plus de malades étrangers.
Nous avons des atouts : outre le bon niveau de la médecine française au quotidien, et des niches d’excellence, notamment en chirurgie, nous possédons un maillage unique au monde de structures de soins privé et publics. Ce réseau est une véritable chance, mais à la condition de donner à chaque établissement des missions bien ciblées plutôt que de les laisser faire tous la même chose par crainte des restructurations électoralement risquées. Nous avons aussi de grandes tares : notre dramatique faiblesse en recherche, en industrie médicale de pointe tant dans le domaine de la pharmacie que dans celui de l’industrie des matériels médicaux et de l’imagerie. Quand je prescris un scanner, j’enrichis General Electric, Siemens, Philips ou Toshiba ; et quand j’opère avec des instruments de haute technologie, la Sécurité sociale finance les retraites des employés de Johnson & Johnson ou de Tyco, deux compagnies américaines se partageant l’essentiel du marché.
J’ose parier, cependant, pour une inversion de la tendance et une prise de conscience générale : le gâchis médical et financier du système de soins français ne peut plus durer. Nous devons nous adapter à la nouvelle société, celle de la science et de l’information mondialisées. Notre pays peut à bien des égards jouer un rôle déterminant en matière de santé. Mais avant de réclamer notre dû, songeons à nos devoirs et à nos responsabilités.
Retrouvez dans La santé n’est pas un droit (Bourin éditeur) 10 propositions majeures pour une autre médecine plus solidaire et moderne.
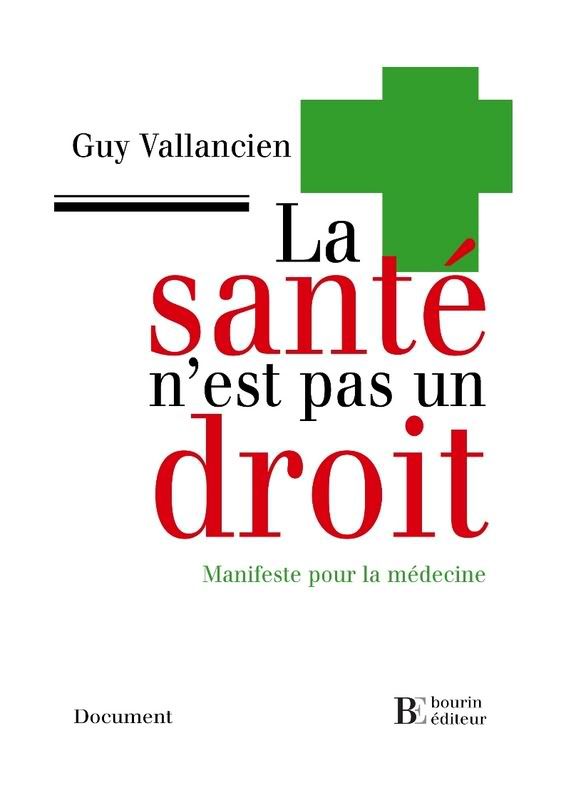




/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F4%2F240955.jpg)